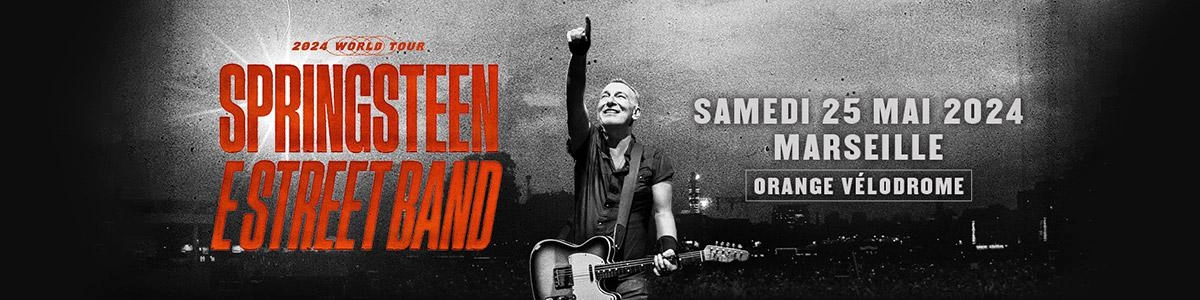Pourquoi Bruce Springsteen plaît tant aux Français
A bientôt 65 ans, le Boss sort ce mercredi son dix-huitième album, « High Hopes ». Il peut compter sur ses fans français : depuis « Born in the USA », le chanteur entretient une relation particulière avec l’Hexagone.
Quarante-cinq ans de carrière. Dans la musique, longévité n’est pas forcément synonyme de renouvellement. Les Rolling Stones sont un pâle reflet de leur gloire passée, Bob Dylan fait de la peine, Neil Young fait surtout de la politique. Le seul à montrer autant de vigueur que lorsqu’il était un chanteur parfaitement inconnu, en 1969, c’est Bruce Springsteen qui revient avec un dix-huitième album, « High Hopes ». Et avec un fan-club toujours aussi soudé.
Particulièrement en France, où « le Boss » vient en tournée depuis 1981 et son concert au Palais des sports, et qu’il a honoré au Stade de France le 29 juin 2013. Pourtant, que Springsteen remplisse les stades dans l’Hexagone peut sembler incongru, avec son accent traînant du New Jersey et ses chansons qui portent sur la misère des ouvriers aux Etats-Unis. Bizarre, de voir un chanteur américain fasciner autant les Français.
« Un gros dépucelage puissance mille »
Fasciner est le mot. Il suffit d’entendre Eric Dérian, dessinateur de bande dessinée, raconter son premier contact avec Springsteen :
« C’était en 1984, j’avais 13 ans, j’étais un gamin mal dégrossi qui n’écoutait même pas la radio. Un jour, je me suis retrouvé dans un fast-food à Bordeaux avec ma mère. Au fond, il y avait cette télé qui passait en boucle cinq ou six clips. Et parmi eux, “Dancing the Dark”. J’ai été scotché, je ne pouvais plus détourner mes yeux de l’écran. Quelques jours plus tard, je suis revenu avec mon argent de poche, acheter “Born in the USA” à la Fnac.
Le premier concert, c’était en 1988. Je passais mon bac de français, j’avais six jours de battement, et j’ai dépensé mon argent de poche pour me payer le billet et un bus qui m’a amené de Bordeaux à l’hippodrome de Vincennes. C’était son seul concert en Europe pour la tournée “Tunnel of Love”. Ce fut un gros dépucelage puissance mille : il y avait 80 000 personnes, j’étais à quinze ou vingt mètres de la scène, ça a duré quatre heures… Je ne suis même pas sûr, le souvenir est sans doute plus beau que la réalité… Je ne me souviens pas du retour. Depuis, j’ai dû enchaîner douze ou quinze concerts du Boss. »
« Springsteen crée quelque chose d’épique »
Car s’il est bien un point sur lequel tous les fans et amateurs du Boss sont formels, c’est bien le talent de bête de scène qui se dégage de Bruce Springsteen : capable d’attirer les foules d’un bout à l’autre des Etats-Unis et dans le monde entier, un show sans interruption de trois ou quatre heures, où le chanteur enchaîne les tubes.
Pour Thomas S., étudiant, c’est cet élément qui fait la force de Springsteen :
« C’est un chanteur dylanien, mais Dylan n’a pas ce côté fédérateur qui lui permet de remplir des stades. Alors que Dylan, c’est du folk tout bête avec une guitare, un harmonica et une voix de canard, Springsteen te réinvestit ça en quelque chose d’épique, du rock chanté d’une voix magnifique. U2 lui a tout piqué. Trois heures trente de show, c’est pas commun. »
Lucie T., professeur de français, qui a été à son dernier concert au Stade de France, voit dans les prouesses scéniques du Boss quelque chose qui traduit son rapport fusionnel aux fans :
« Dans le clip de “Dancing in the Dark”, qui est en fait le film d’un de ses concerts, on le voit attraper par la main une jeune fille du public – une toute jeune Courteney Cox – et l’amener danser sur scène. Il a renouvelé ça dans chaque concert pendant des années. Ou dans “Streets of Philadelphia” [voir plus bas], il marchait seul dans la rue, en anonyme, un micro caché sous sa veste.
Dans ses chansons, il parle au prolo de base, le milieu auquel il appartenait, et on sent qu’il n’a pas perdu de vue ce qu’on peut appeler les gens ordinaires. Il y a des groupes, on a l’impression qu’ils s’en foutent de chanter à Paris, à Tokyo, à Madison Square ; lui, on sent qu’il communique avec la foule. »
« Ses cachets, c’est sa seule zone d’ombre… »
Qu’il chante les vétérans du Viêt Nam (« Born in the USA ») ou reprenne les cris de colère de Woody Guthrie et de John Steinbeck (« The Ghost of Tom Joad »), on peut cependant faire la moue devant ce paradoxe vivant : un fils d’ouvriers, chanteur de la misère et de la décrépitude du rêve américain, qui aligne pourtant les cachets extrêmement coquets. Comme le dit Eric :
« Tu sors de trois heures de concert pour trouver le T-shirt à 35 euros à la sortie. »
Hypocrite, le Boss ? Absolument pas, s’insurge un autre fan, Julien Prigent, journaliste à La Charente libre :
« Springsteen ne crée pas de distance : il a les mêmes musiciens depuis des années, qu’il quitte et requitte, il a sa bande de copains qu’il ne quitte jamais, il reste fidèle à sa terre natale, il nous renvoie l’image d’un gars qui nous ressemble. Ses cachets, c’est sa seule zone d’ombre… Et on s’en fout.
En plus, il a cette image très clean : il n’a pas un gramme de graisse, il fait du sport, il n’a jamais fumé, ne s’est jamais drogué, il a dû boire sa première bière à 25 ans… Ça change des chanteurs trash des années 60 et 70, et c’est peut-être ça qui fait sa force : il n’a jamais dérapé, faute de mettre le nez dedans, et il est resté lui-même. »
Springsteen a reçu l’Oscar de la meilleure chanson et le Grammy Award de la chanson de l’année en 1994 après l’avoir écrite pour le film « Philadelphia », de Jonathan Demme
Eric abonde dans ce sens d’un chanteur propre sans être aseptisé, et qui lui a permis d’être inoxydable aux yeux des médias comme du public :
« Ça fait du bien, ce côté clean. On était en pleine période de chute libre des Rolling Stones, et tout d’un coup arrive ce type qui nous montre, à nous Européens, ce qu’on ne connaissait pas : Springsteen, c’est l’Américain de gauche, avec tous les paradoxes qu’il y a dedans. Or, dans les années 80, l’Amérique, c’était Dallas.
Oui, il touche des cachets énormes, et alors ? Tout ce qu’il fait avec son pognon, c’est payer un cheval à sa fille, et c’est tout. Sa seule histoire de mœurs, c’est quand il a quitté sa femme. Alors que des chanteurs se sont construits sur la rumeur, comme Michael Jackson, il n’y a pas de rumeur sur le Boss. Et c’est ça son mystère. »
Le cauchemar américain
C’est enfin dans ces thèmes que Bruce Springsteen s’affirme le plus : son portrait au vitriol et très critique de l’Amérique au chômage, à la rue, frappée par la misère, mais néanmoins toujours avide d’espoir et du rêve américain.
« Darkness on the Edge of Town » fait la chronique sombre du sort des cols bleus aux Etats-Unis,
« Born in the USA » était un réquisitoire contre Ronald Reagan,
« The Rising » parle des attentats du 11 Septembre,
et l’avant-dernier en date, « Wrecking Ball », médite sur la crise financière.
Pour Julien Prigent, cet héritage des chanteurs de la Grande Dépression est criant :
« C’est un chanteur engagé, qui parle de thèmes révolutionnaires avec un message d’espoir que le bonhomme sait très bien servir avec son charisme. C’est l’Europe qui lui réserve le plus grand accueil, et ce sont dans des pays de culture révolutionnaire comme l’Espagne ou l’Italie qu’il attire le plus de foules. Comparé à ces pays-là, la France est à la traîne. »
« Il dresse le portrait d’un pays taillé au vif par les inégalités, mais il garde cet amour de son prochain, sa foi dans les gens. Il a ce côté pastoral parce qu’il parle de gens comme lui, mais qui n’ont pas suivi la même route que lui. Je ne dis pas qu’il prêche, pas du tout ; mais il communie avec son public. Ce type est malin comme un singe pour ce qui est de faire passer son message. »
« Born in the USA » détourné par Reagan
Clément B., étudiant en théâtre, rappelle ainsi qu’à son grand dam, Springsteen était devenu l’idole des conservateurs reaganiens en 1984, après la sortie de « Born in the USA », perçu comme un hymne chauvin alors que la chanson raconte le rejet par la société d’un vétéran du Viêt Nam.
« Bruce est un produit du rêve américain brisé par la guerre du Viêt Nam qui avait besoin de se rassurer. Il est très comparable à Rocky Balboa : dans le film original, Rocky, c’est juste un prolo complètement tocard, qui perd à la fin mais qui aura fini par croire en lui-même et par faire un effort. Avec son image de beau gosse musclé et romantique, Springsteen incarne l’Amérique triomphante mais qui n’oublie pas ses racines. Sylvester Stallone a perdu ses racines devant le dieu dollar, mais pas Bruce. »
Pour cette petite nébuleuse de fans, chaque album du Boss est un moment de joie : on s’enferme pour réécouter tous ses albums pendant deux semaines, on le critique au début mais on finit par le défendre bec et ongles. Il a flirté avec le gospel, la musique irlandaise, le folk, avec la chanson sentimentale comme l’engagement : donc, Bruce Springsteen est encore capable, à 64 ans, de se renouveler. C’est peut-être ça, le rêve américain.